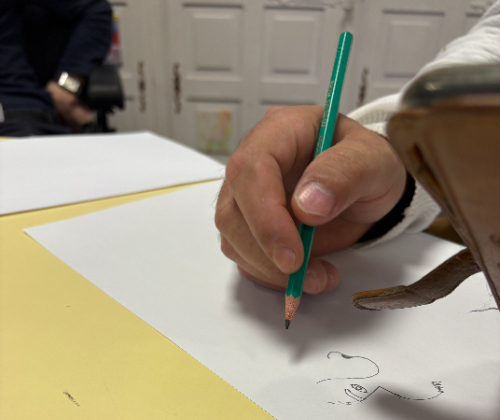La Fondation
actualité
140 ans
L’héritage de Léopold Bellan : 140 ans d’innovation
15/04/2025
Matthieu Laîné est Directeur Général de la Fondation. Il analyse son développement au cours des dernières décennies et les recettes de sa longévité.
Comment et pourquoi l’Association Léopold Bellan est-elle devenue une fondation ?
Matthieu Laîné En 1996, l’association est en bonne santé financière et déjà reconnue pour sa gestion rigoureuse. En revanche, sa gouvernance était un peu fragile. Transformer l’Association en Fondation lui a donné une assise plus solide, en consacrant son patrimoine à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général. Ceci sous la protection et même la surveillance de l’Etat, puisque la Fondation est reconnue d’utilité publique. A ce titre, des représentants de l’Etat siègent, de droit, au sein de notre Conseil d’administration, qui compte également une dizaine d’administrateurs bénévoles engagés. Une Direction Générale est alors constituée, avec la volonté qu’elle incarne une autorité importante en pilotant au quotidien les activités développées par la Fondation.
On observe alors des évolutions importantes dans la société…
En 1995, le « plan Juppé » sur la sécurité sociale instaure une politique de rationalisation de moyens et la mise en place de la tarification à l’activité à l’hôpital. En 2002, une nouvelle loi réforme en profondeur la règlementation de l’action sociale et médico-sociale. La canicule de l’été 2003 incite les pouvoirs publics à allouer des moyens importants aux secteurs des personnes âgées et des personnes handicapées, ce qui conduit à la création de la journée de solidarité et de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).
La Fondation s’inscrit dans cette évolution et répond aux besoins sociaux ?
Absolument. La Fondation continue son histoire : nous avons répondu à des besoins non couverts, repris des associations en difficulté, développé notre activité médico-sociale, notamment dans celui du handicap. Sur le plan sanitaire, la mise en place de la tarification à l’activité nous a conduit à des choix stratégiques : l’Hôpital Bellan, établissement historique, connaissait des difficultés financières. Sa taille n’était pas suffisante pour continuer à mener ses activités médico-chirurgicales et d’urgence, dans un arrondissement où coexistaient de nombreuses offres hospitalières. Nous avons décidé de recentrer son activité sur la gériatrie, pour en faire depuis une filière d’excellence.
La Fondation n’est pas seulement reconnue pour être une bonne gestionnaire mais pour la rigueur de ses accompagnements. D’où vient cette culture de la qualité ?
Nous sommes là pour accompagner les personnes, c’est notre objet social et notre métier, il est donc essentiel que nous le fassions sérieusement. Je dirais aussi que la qualité prémunit contre les difficultés économiques. Cela fait 140 ans que nous existons parce que les professionnels ont bien fait leur travail. Notre charte « maison » de lutte contre la maltraitance date de 2003, mes prédécesseurs étaient pionniers dans ce domaine. Pour les pouvoirs publics, c’était rassurant. Ils incitent d’ailleurs depuis 20 ans les opérateurs en difficulté à se rapprocher de ceux de taille plus importante, qui avaient expérimenté plusieurs publics, reconnus pour leur sérieux. Nous avons ainsi participé à la consolidation du secteur.
Avec la volonté d’être autonomes ?
Nous avons toujours voulu accompagner les stratégies des pouvoirs publics, tout en affirmant notre capacité à gérer nos établissements de manière responsable. La naissance des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM) dans les secteurs sanitaires et médico-sociaux date de cette époque : l’Etat vous délègue la gestion d’un établissement, vous donne les moyens, mais vous demande un travail de qualité. Nous avons signé l’un des premiers CPOM, interdépartemental, en 2008, avec 6 ou 7 préfets ! Et négocié des moyens qui nous ont permis de créer des postes reflétant les priorités des pouvoirs publics de l’époque : s’adapter à la révolution numérique, développer et contrôler une démarche qualité structurée, vérifier le pilotage économique.
Qu’en est-il aujourd’hui de la coopération entre l’Etat et les organismes gestionnaires ? Depuis le Covid, nous sommes dans un entre-deux. Les modèles économiques sont dépassés, celui des Ehpad est à réformer ce qui suppose des investissements massifs. Par ailleurs, les CPOM, qui étaient autrefois négociables, sont devenus des contrats obligatoires, ce qui les dénature et limite les marges de manœuvre des établissements. Enfin, les conseils départementaux rencontrent des difficultés pour financer les domaines dont ils sont pourtant responsables, comme la Prime Ségur pour les établissements relevant de leur compétence.
Comment la Fondation s’adapte-t-elle aux incertitudes qui pèsent sur l’organisation du secteur pour ces prochaines années ?
Nous répondons aux évolutions des besoins des personnes que nous accompagnons. Nous avons axé notre projet stratégique sur la transformation de l’offre, l’inclusion et l’autodétermination. Nos établissements ne sont plus seulement des lieux de vie, mais aussi des plateformes d’expertise au service des territoires.
Ces évolutions correspondent aux attentes des résidents et des personnes âgées, qui ont envie de vivre chez eux, des familles et enfants en situation de handicap qui souhaitent plus de visibilité dans la société, des patients qui veulent être soignés en ambulatoire…Nous menons également une réflexion sur le partage des ressources médicales et sociales. Par exemple, nous souhaitons que les compétences des soignants spécialisés dans la maladie d’Alzheimer et des équipes d’animation des Ehpad puissent bénéficier aux personnes âgées vivant à domicile sur le territoire. Cette approche permettrait de renforcer l’accompagnement tout en évitant les ruptures dans le parcours de soins.
Continuer à se développer fait toujours partie du projet stratégique de la Fondation ?
Nous avons 140 ans d’histoire à préserver et prenons d’abord soin de nos établissements existants, qu’il faut accompagner dans leurs transformations. Cependant, nous saisissons les opportunités qui ont du sens et confortent nos activités : la reprise d’une association spécialisée dans l’épilepsie adulte, proche de nos établissements du Val-de-Marne, pour y créer un pôle dédié à cette maladie ; la reprise de deux établissements à Creil -bassin où nous sommes déjà présents- pour fluidifier les parcours et s’ouvrir au savoir-faire de l’accompagnement du handicap moteur et de l’handisport…
Forte de son expérience et de son expertise, la Fondation réputée discrète fait-elle davantage entendre sa voix ?
Oui, mais plus encore, nous portons celle des personnes que nous accompagnons. C’est l’objectif de notre communication que nous avons développée, pour leur donner une visibilité accrue. C’est aussi le souhait des personnes en situation de vulnérabilité, souvent marginalisées, qui expriment de plus en plus leur volonté de participer à la vie citoyenne. Nous nous engageons ainsi en matière de transition écologique ou de transformation numérique. Pour cela, il nous faut obtenir des financements et des règles claires de la part des pouvoirs publics et nous les interpellons plus systématiquement.
Pour terminer, pourriez-vous évoquer quelques projets que vous avez eu à cœur d’accompagner, depuis votre entrée à la Fondation en 2008, au poste de Directeur adjoint en charge du développement ?
J’ai eu la chance d’assister à toutes les étapes de la construction de l’Ehpad de Romainville (ouvert en 2018) : un bel établissement dans un département où nous n’étions pas implantés, dans une ville de 30 000 habitants -souvent aux revenus modestes, sans hébergement pour personnes âgées dépendantes. La transformation de l’Institut médico-éducatif de Châteaudun en Dispositif d’accompagnement médico-éducatif est un projet extraordinaire porté par les professionnels. Ses résultats en termes d’inclusion -80% des enfants sont scolarisés dans leur école ou collège de secteur- sont impressionnants. Cela fait du bien aux jeunes et les familles sont satisfaites. La relocalisation du pôle épilepsie de Créteil à Combs-la-Ville (prévue en 2027) témoigne de notre capacité à reprendre et transformer une association en difficulté. Nous avons trouvé un terrain qui nous permettra de développer des surfaces généreuses, avons été très soutenus par l’ARS pour avoir bien travaillé avec l’association des familles d’enfants épileptiques d’IDF et pris en compte leurs demandes. Cette co-construction fait partie de la démarche de tout nouveau projet. Ce sont ces projets concrets qui donnent tout son sens à notre mission !